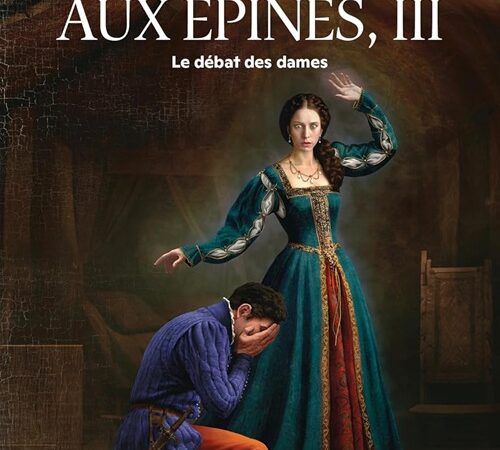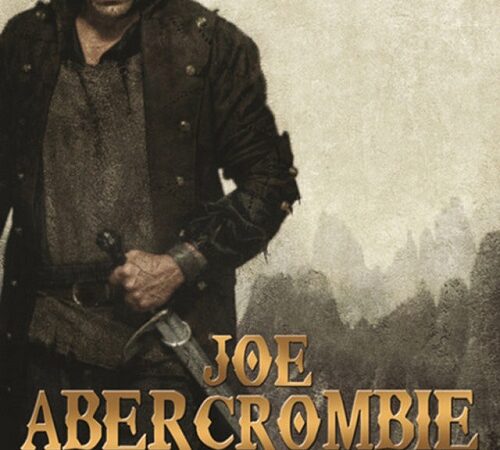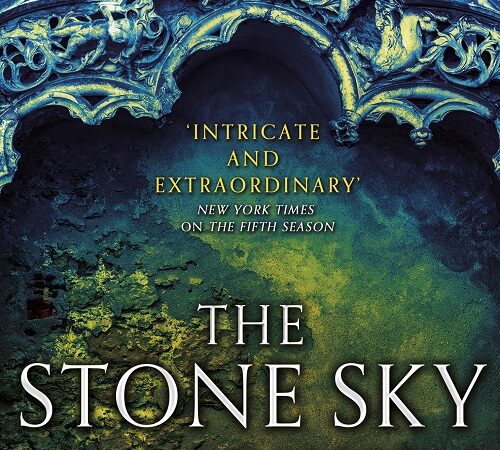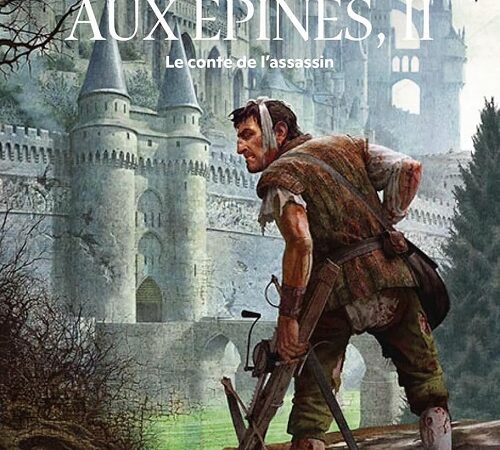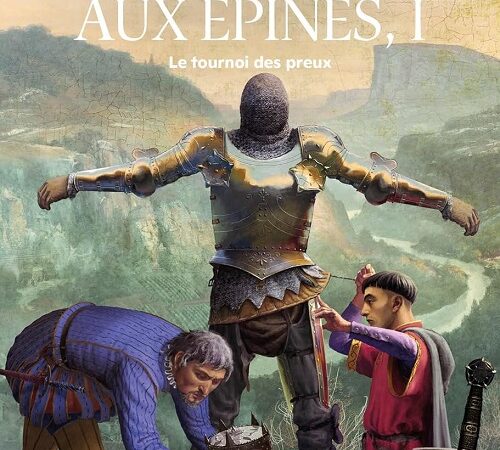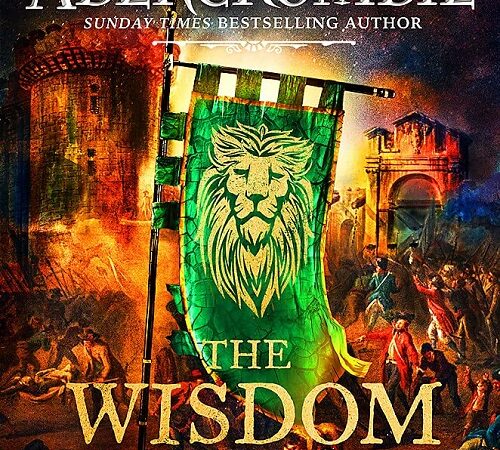ROBERT JORDAN – The Eye Of The World (L’oeil du monde)
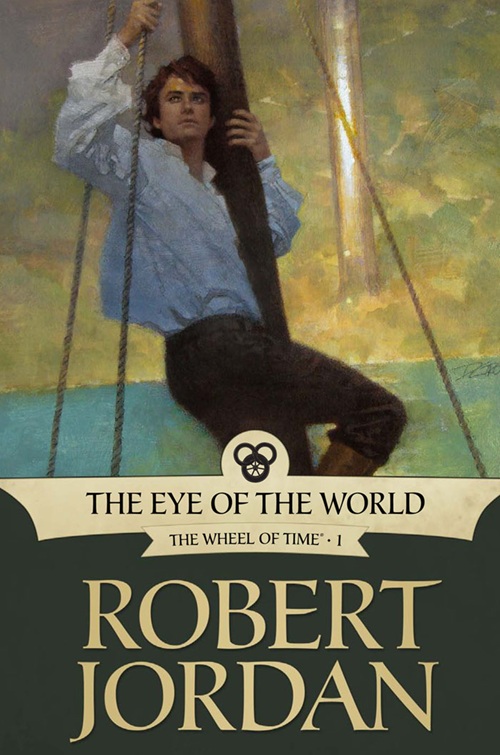
De jeunes fermiers, ignorants de ce qui agite le monde alentour et qui doivent quitter la douceur de leur contrée précipitamment, pourchassés par des êtres diaboliques et encapuchonnés. Une compagnie qui se forme entre ces villageois ingénus et des aventuriers expérimentés, dont on devine qu’ils cachent de funestes secrets. Une rivière à traverser dans la plus grande précipitation, pour échapper aux poursuivants. Une auberge que l’on prend pour un refuge, mais que les forces du mal ne tardent pas à assaillir. Des ruines lugubres, souvenirs de temps tragiques et héroïques, devenues le repaire de fantômes. Des péripéties qui séparent les héros en trois groupes distincts. Un seigneur du Mal emprisonné dans sa forteresse, au milieu de terres dangereuses et empoisonnées, et qui ne demande qu’à restaurer son antique pouvoir. Le souverain déchu d’un royaume perdu, jeté sur la route, et devenu un guerrier sans peur ni reproche. Un être consumé par la peur, à la fois pathétique et malfaisant, qui suit à la trace les héros, quels que soient les endroits périlleux où ils s’aventurent.
A en croire ces éléments, cette histoire pourrait être Le seigneur des anneaux. Il s’agit pourtant d’une autre œuvre, écrite un demi-siècle plus tard, et devenue, à l’instar de celle de Tolkien, le cycle de fantasy emblématique de son époque : cette fameuse Roue du temps de Robert Jordan. Ou plus précisément L’oeil du monde, le tout premier volet de cette série fleuve de plus dix mille pages.
C’est la loi de la littérature de genre : reprendre sans cesse les mêmes ressorts, les mêmes procédés, les mêmes recettes, et tenter de les développer, de les enrichir, de les affiner, de leur donner aussi, parfois, une teinte différente, quelquefois de les bousculer et de les dépasser. Dans les premiers chapitres de L’oeil du monde, toutefois, les similitudes avec le livre phare du genre sont patentes, elles crèvent les yeux. Comme si Robert Jordan n’avait pour but que d’actualiser l’œuvre de Tolkien.
Et il y parvient. Son livre est plus moderne, plus contemporain, il apporte des couleurs fraiches à une trame ancienne. Il la toilette, il la rénove, notamment par le rôle qu’il donne aux femmes. Dans La roue du temps, même si les protagonistes principaux sont trois garçons, celles-ci occupent une place de premier plan, via plusieurs personnages : Moiraine l’Aes Sedai, Nynaeve la guérisseuse et Egwene, l’amie d’enfance du héros, Rand al’Thor. Ce sont elles qui portent la culotte, au village. Des reines sages, fortes et puissantes gouvernent une partie du monde. Surtout, seules les femmes maîtrisent la magie, les hommes à même d’en faire autant ayant tous été corrompus dans les temps anciens.
Aussi, ce qui chez Tolkien avait été assimilé à des préjugés raciaux, a disparu chez Jordan. Il prend soin d’éviter les vieux stéréotypes quand il décrit des races et des peuples. De même, le petit groupe formé par les héros de La Roue du Temps ne ressemble plus à une ménagerie. Ce n’est pas un assemblage éclectique de créatures de mythes ou de contes. A l’exception de Loial, l’Ogier, tous sont des humains. Malgré une magie spectaculaire, les héros de Jordan, même les plus puissants, même les rois et les mages, se distinguent par leur normalité. Ils sont des hommes, pas des idéaltypes.
Ce qui change, aussi, c’est la conception du temps. Chez Tolkien, le récit s’inscrivait dans un temporalité linéaire. Son histoire prenait place sur ce qui pouvait être notre Terre, en des temps lointains. Il racontait la sortie du mythe, l’avènement d’une humanité devenue force motrice du monde. Chez lui, le sentiment de nostalgie se confondait avec la nécessité du progrès, et l’homme était dépositaire de son destin. Jordan, au contraire, comme le titre même du cycle l’indique, s’inscrit dans un temps cyclique. Il est question d’un héros antique réincarné, dont les actions sont dictées par le destin, par les prophéties, plutôt que par son libre-arbitre. Le retour des temps mythiques est annoncé. Et l’un des leitmotivs du roman est le suivant : « there is neither beginning nor end ». Toute idée de fin de l’histoire, de progrès inéluctable, d’humanité amendée, semble remisée au placard.
Robert Jordan ne se contente pas d’actualiser une recette éprouvée. On trouve aussi, chez lui, une certaine modernité d’écriture. Sans encore faire du roman psychologique déguisé en fantasy, à la manière d’une Robin Hobb, l’auteur dote ses personnages d’une certaine épaisseur. Malgré son cortège de monstres et d’artefacts magiques, il ancre davantage encore le genre dans la littérature réaliste, par la façon dont il anime ses héros de sentiments et d’états d’âme, par la manière dont il les fait grandir, mûrir et évoluer de manière crédible. Cela facilite d’autant plus l’identification du lecteur à ces villageois en voie de devenir des figures mythiques, mais encore normaux et attachants.
Même maîtrise dans la narration. Comme beaucoup d’auteurs de fantasy moderne, Jordan s’attache à faire durer le plaisir, le long de centaines de pages, au cours de nombreux chapitres, amenés à se multiplier en plusieurs tomes. Mais il évite les écueils qui menacent ce genre d’entreprise : d’abord, la surdose d’événements triviaux et répétitifs ; ensuite, son contraire, les longs chapitres d’attente où rien ne se passe, où les mots ne sont là que pour meubler. L’œil du monde est construit en crescendo, tout est concentré vers la préparation d’une apothéose, d’un combat apocalyptique à grand spectacle. Mais avant d’en venir à cette fin ébouriffante, nul moment d’ennui, nul mot superflu, nul épisode anodin, rien n’est destiné à rallonger artificiellement le récit. En tout cas pas encore. Car la suite, démesurée, s’acharnera à complexifier ce roman encore simple et fluide qu’est L’oeil du monde.
Acheter ce livre en VO
Acheter ce livre en VF